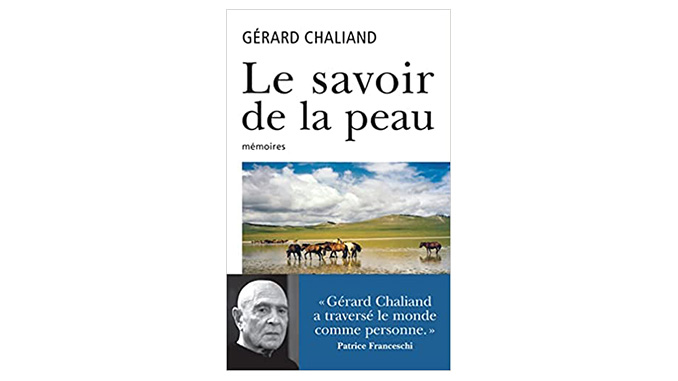
C’est peu dire que Gérard Chaliand a roulé sa bosse. Il est allé sur tous les continents, a fréquenté toutes les guérillas (ou presque) et avoue qu’au cours des 35 dernières années, il n’a jamais dormi plus d’un mois au même endroit. Mais cet infatigable « bourlingueur » était aussi un homme de réflexion, auteur prolifique, conférencier apprécié, conseiller écouté. Son ouvrage « Le savoir de la peau », aux éditions L’Archipel, est un livre à la fois de mémoire et de réflexions qu’il nous livre.
Vous aimez jeter un regard froid et lucide sur les conflits, mais vous vous êtes engagé pour la reconnaissance du génocide arménien.
Je me suis impliqué dans le combat pour la reconnaissance du génocide des Arméniens après un quart de siècle de rupture avec cet héritage (le « d » de mon nom est une lettre de rupture). Je ne supportais pas ce masochisme des vaincus qui caractérisait les Arméniens en général. Durant un quart de siècle, j’ai parcouru un monde en rapide transformation à travers la violence et j’aimais ces luttes où des peuples cherchaient à modifier un ordre qui ne leur convenait plus. La « question arménienne » a refait surface vers 1975. Elle est une conséquence des luttes de décolonisation et s’est exprimée à travers des assassinats de représentants d’un État qui se refusait à admettre les faits, c’est-à-dire la liquidation de masse d’une population.
C’était ce que j’ai dénommé du « terrorisme publicitaire » destiné à faire connaître une histoire condamnée à rester dans les oubliettes de l’histoire ; mais cette pratique a connu des dérapages nuisibles (attentats d’Orly) pour la cause ainsi défendue. Il m’a semblé qu’il fallait un terrain plus conforme à cette cause. D’où l’idée, d’un Tribunal international destiné à examiner le dossier historique et politique des événements de 1915-1917. Composé de personnalités indiscutables dont Sean MacBride (créateur d’Amnesty International et lauréat du prix Nobel de la paix), les débats se sont tenus à la Sorbonne et le verdict a été rendu à l’Assemblée nationale. C’était le début d’une longue campagne qui recevait la reconnaissance de la France parmi nombre d’États, de l’Allemagne alliée de l’Empire ottoman et enfin des États-Unis. Après avoir lutté pour la liberté de nombreux peuples, c’était ma contribution. Personnellement, dans ma famille paternelle, on s’est battu et on est mort les armes à la main. C’est à cette tradition que je me rattache. Je rends hommage à mon pays, la France, qui a permis la tenue de ce Tribunal.
D’une façon générale, j’ai cherché à rendre compte des événements le plus lucidement possible afin d’établir un état des lieux qui a du sens. Je n’aime pas les prises de positions idéologiques où l’on a la réponse avant même que la question soit posée. La connaissance de l’histoire et du terrain m’a toujours semblé essentielle.
En 1983, vous publiez un best-seller mondial avec l’Atlas stratégique refusé par plusieurs éditeurs.
En effet, j’ai, avec Jean-Pierre Rageau, publié en 1983 un Atlas stratégique concernant les rapports de force mondiaux qui avait l’originalité de montrer le monde sous ses diverses facettes. Cela nous changeait de la façon habituelle de montrer le monde soit avec notre vision autocentrée européenne, soit à la manière américaine où l’hémisphère ouest était centrale. Rien sur la façon dont le monde était perçu par d’autres, à commencer par la Chine; mais aussi en montrant que d’autres États avaient une conception de leurs intérêts géopolitiques. Cet Atlas a été refusé par une demi-douzaine d’éditeurs, la géopolitique et la stratégie n’étant pas à l’honneur. Seul Fayard, alors dirigé par Claude Durand, qui avait le sens du risque et le goût de l’innovation y consentit.
J’ai eu la chance de passer à la télévision dans l’excellente émission de Bernard Pivot et cela déclencha un succès immédiat. 80 000 exemplaires furent vendus en quelques semaines et le livre fut traduit en anglais chez Harper & Row aux États-Unis (une première pour un atlas français) et en Grande-Bretagne par Penguin, également avec succès. Cet Atlas a été par la suite à l’origine du renouveau de la géographie politique et s’est vendu avec sa version en poche (Complexe, Bruxelles) à quelque 200 000 exemplaires. Nous étions volontiers conservateurs contrairement aux Américains qui essayaient volontiers de publier de l’inédit par goût du risque.
Vous racontez qu’un des membres des services de sécurité américaine auquel vous demandiez quelle différence il faisait entre l’Afghanistan et l’Irak, deux terrains qu’il connaissait, répondit : « Ce sont tous des musulmans en Afghanistan. Le terrain est plus montagneux ». La puissance peut-elle compenser l’ignorance ?
Non, mais la puissance par excès de confiance en ses moyens l’empêche souvent. Cela a été le cas fréquemment au cours des dernières décennies des États-Unis qui ne se donnaient souvent pas la peine de chercher à connaitre la perception des adversaires qui leur étaient très largement inférieurs en puissance. Non que les États-Unis ne disposaient pas de spécialistes capables de saisir la complexité d’un rapport de force, tel que par exemple Bernard Fall sur le Vietnam, mais ils n’étaient pas entendus. Ce dernier qui connaissait admirablement le terrain a très tôt perçu que la guerre ne débouchait pas sur une victoire, au contraire. L’impréparation par arrogance a été manifeste chez les néoconservateurs en Irak et par la suite avec d’autres en Afghanistan. Entre-temps, le syndrome vietnamien comme on l’a dénommé, amenait les États-Unis à abuser des « dégâts collatéraux » qui leur aliénaient les populations. D’autant plus qu’ils appuyaient des régimes impopulaires, corrompus et inefficaces.
La guerre asymétrique, c’est-à-dire le rapport du « faible au fort », s’établit sur la durée par l’acceptation chez le « faible » de perdre une quantité de troupes fortement motivées. Cela renverserait la donne dans la mesure où le « fort » ne parvenait pas à éradiquer le « faible » ce qui, à l’usure, assurait à ce dernier de finir par épuiser un adversaire dont l’opinion publique ne soutenait plus une guerre interminable et coûteuse. Puis l’arrière devenait plus vulnérable que les combattants. Cela posait le problème de la dimension sociale de la guerre sans doute née du relatif déclin démographique du « fort ».
Le tournant se situe sans doute lors de la guerre d’Irak où pour la première fois, dans la longue histoire de la guerre, on n’a pas donné le nombre de soldats irakiens morts au combat. La coalition dirigée par les États-Unis perdait quelque 300 hommes et les services britanniques estimaient les pertes militaires irakiennes à 70 000 environ. À l’heure de la « guerre zéro mort », l’opinion occidentale aurait été choquée par la disproportion.
Rien n’est peut-être plus important pour répondre à votre question que de connaître son adversaire, sa perception et son degré de motivation. Il y a loin entre ceux qui sont prêts à sacrifier leurs vies et ceux qui combattent (surtout s’ils ne sont pas volontaires) pour obtenir la carte verte ou payer l’achat de leur domicile.
Dès 2008, vous tirez la sonnette d’alarme sur le fait que la guerre d’Afghanistan ne peut pas être gagnée. Comment expliquer l’entêtement américain et occidental ?
Le constat de l’échec est une chose difficile, et plus difficile encore de l’admettre et d’en tirer les conséquences. On essaye de changer de tactique et de passer par exemple à la contre-insurrection en allant en force sur le terrain avec les risques que cela comporte. Souvent, c’est trop tard, l’adversaire est déjà maître des populations et il aurait fallu commencer plus tôt. Ou bien l’on décide comme l’a fait Obama d’envoyer des renforts pour mieux occuper le terrain, mais c’est souvent bien tard. La situation est « pourrie » et le régime qu’on soutient est si impopulaire. Se retirer c’est admettre la non-victoire c’est-à-dire l’échec politique. C’est Donald Trump qui a décidé d’en finir en légitimant les Afghans qui combattaient les Américains, en consentant à négocier avec eux parce qu’il estimait la Chine comme la rivale majeure.
Ceci ne menait pas nécessairement au retrait honteux subi par Biden. La guerre d’Afghanistan était perdue en 2008 et irrémédiablement au plus tard en 2011 (dix années perdues sur le plan budgétaire et sur l’influence américaine). Le bilan concernant les pertes militaires en revanche est dérisoire : 125 soldats par an donnent en 20 ans la somme de 2500 morts. On tue davantage à New York annuellement.
En matière de coercition (Hard power en franglais), la démonstration est un échec et les États unis n’ont pas été convaincants en matière de pouvoir feutré (Soft Power en franglais). Leur influence a été mise à mal. Il n’est pas facile de gagner une guerre dans un pays qu’on connait mal tandis qu’on soutient un régime largement impopulaire, surtout quand on veut à tout prix éviter de perdre ses soldats.
Jadis, à la période coloniale les troupes et les officiers restaient longuement sur le terrain. Les officiers britanniques restaient dix ans en Inde au milieu du XIXe siècle. Même si l’on ne jouait au polo qu’entre soi, on était familier des coutumes du pays, on le connaissait et on savait qui était qui. À la période contemporaine, les Américains restent un an. Comme l’a constaté il y a plus de dix ans le général Stanley McChrystal chargé d’établir un rapport publié dans le Washington Post, les troupes dans leur immense majorité ne sortaient que très rarement de leurs bases où elles étaient en quelque sorte « en transit ». Ceci par crainte d’embuscades et d’opérations suicides. La méconnaissance du terrain était en Afghanistan à peu près totale. On ne parle pas la langue (un seul membre de l’ambassade parlait le Dari en 2008,) on ne connait pas les coutumes (qu’on méprise) et l’on évite par précaution, le contact avec les populations même lorsque l’on est chargé à la campagne de les aider. On vit en camp retranché. Et l’on raconte que l’on cherche à gagner les cœurs et les esprits alors que l’on ne gagne pas même à la campagne les estomacs.
