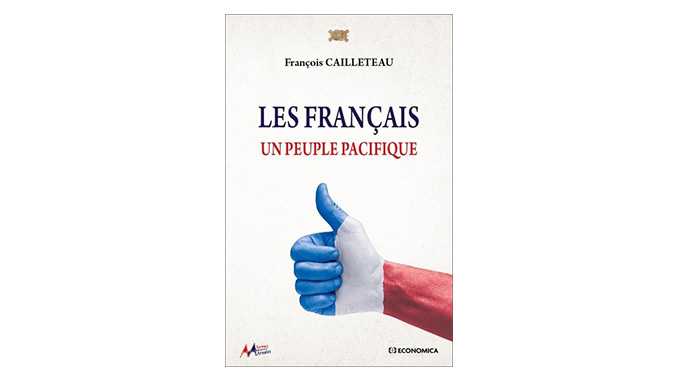
François Cailleteau, qui a fini sa carrière militaire comme chef du contrôle général des armées, est l’un des plus fins analystes des questions militaires en France. Il répond à mes questions à l’occasion de la parution de son ouvrage « Les Français, un peuple pacifique » aux Éditions Economica.
Vous opposez des dirigeants, tous régimes confondus, toujours prêts à des interventions militaires extérieures, et un peuple français, beaucoup plus difficile à mobiliser…
Comment les dirigeants français ont-ils permis à la France d’obtenir la première place mondiale dans l’activité guerrière au cours des siècles alors que le peuple a manifesté presque constamment sa réticence à y participer ? Soit en s’abstenant de le consulter, soit en ignorant son avis. De la monarchie absolue, qui ne réunit plus les États généraux aux régimes, de 1815 à 1870, dont les parlements ne sont pas représentatifs, en passant par la dictature napoléonienne, on ne consulte pas le peuple. Depuis la Troisième République, on oublie souvent son point de vue. C’est Jules Ferry, renversé deux fois pour sa politique coloniale qui est néanmoins poursuivie, c’est Guy Mollet, élu sur un programme de négociations avec la rébellion algérienne et qui choisit la guerre à outrance. Encore aujourd’hui, les opérations extérieures sont lancées sur la seule décision de l’exécutif. En réaction, le peuple a presque toujours résisté à participer à ces entreprises.
Même l’appel au volontariat en 1792 ne fut pas un succès pas plus que la levée en masse en 1793…
En 1792, on cherche 200 000 volontaires dans la garde nationale, c’est-à-dire parmi les plus engagés dans le mouvement révolutionnaire, volontaires d’ailleurs désignés. On n’en trouve que 160 000. Début 1793, on décide une levée supplémentaire de 300 000 hommes, de moins en moins volontaires (ce sont des volontaires requis). La résistance est encore plus forte : on ne parvient qu’à la moitié de l’effectif et l’on provoque l’insurrection vendéenne. Il fallut la Terreur pour qu’avec son appareil répressif intense, on parvienne à constituer une puissante armée qui, portée à 700 000 hommes en 1794, repoussera les armées ennemies bien au-delà de nos frontières. Dès 1795, on revient à 400 000 hommes : la Terreur terminée, des centaines de milliers de requis rejoignent leurs foyers avec ou, plus souvent, sans l’autorisation de leurs chefs. C’est dire le caractère très reconstruit d’un enthousiasme général pour les armées de la Révolution.
Vous notez une constante depuis la royauté, l’appel aux étrangers pour compléter les effectifs…
Les Français ont rarement suffi à la constitution des armées. Aussi a-t-on constamment fait appel à d’autres ressources. Sous l’Ancien Régime, on a fait appel à des régiments étrangers qui ont constitué un cinquième et jusqu’à un quart des troupes du roi. Alors qu’à l’inverse, il n’y a pas eu de troupes françaises dans les armées étrangères. L’armée de Napoléon reprit cette tradition. Puis, s’il resta presque toujours des étrangers sous le drapeau français, l’on fit appel de plus en plus à la ressource de nos colonies, les troupes indigènes. Dans la guerre d’Indochine, les citoyens français ne comptent que pour 40% du corps expéditionnaire (sans compter les troupes du Vietnam) et sur les 17 bataillons d’infanterie engagés à Dien Bien Phu, seuls 3,5 sont français. Aujourd’hui, la Légion étrangère constitue environ un douzième de l’armée de terre française mais un sixième de son infanterie.
En 1870, les Français acceptent la perte de territoire du moment qu’elle permette le retour à la paix…
L’attitude de la population française après les désastres de l’armée impériale, défaite de Sedan et reddition de Metz, traduit bien les ambiguïtés de son positionnement vis-à-vis de l’engagement militaire. Le gouvernement de la défense nationale que dirige Gambetta poursuit la guerre avec ardeur et met sur pied de nouvelles armées. Mais le flot des volontaires se tarit très vite et la conscription ne fournit pas tout ce qu’elle devrait apporter. Les Français ne veulent pas se battre jusqu’au bout et leur vote de février 1871 désavoue Gambetta et porte au pouvoir Thiers, préférant la paix au prix de la perte de trois départements à la poursuite de la guerre. On peut tracer des parallèles avec l’acceptation de la défaite et du retour des Bourbons, qui promettent la fin de la conscription en 1814, ou avec la popularité de Philippe Pétain actant la fin des hostilités par un armistice particulièrement sévère.
Parallèlement, il y a toujours eu par rapport à nos voisins un faible appétit pour partir à l’étranger. Par exemple au Canada au moment de la guerre de 7 ans, il y a 84 000 de Français contre 1,4 million d’Anglais…
Les Français ont peu quitté la France au long des siècles, en particulier vers les colonies. Sous l’Ancien Régime, rien de comparable entre le peuplement des colonies françaises et celles de l’Espagne, du Portugal ou de l’Angleterre. Il n’est pas facile de trouver des raisons objectives à cet état des choses : la démographie française est à peu près la même que celle des autres pays (forte natalité, forte mortalité), la densité humaine sur le territoire national est plus forte en France que dans ses rivales d’outre-mer, la richesse par habitant plus forte qu’au Portugal mais moins qu’en Angleterre. On doit se résigner à voir là un trait du caractère national : on se trouve assez bien en France pour ne pas s’en trop éloigner. Dans la seconde période coloniale, la situation est différente : la France a une démographie stagnante alors que le reste de l’Europe est dans une phase de croissance très forte : d’où des vagues d’émigration au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, pour n’en citer que les principales. Il en résulte que les Français ont peu de liens avec l’outre-mer et qu’ils seront assez indifférents à son évolution pourvu que l’on ne les oblige pas à y défendre la présence française. Des « arpents de neige » de Voltaire à la perte du Canada, à la satisfaction populaire à la fin de la présence française en Algérie (et au mauvais accueil fait aux Pieds-Noirs rapatriés), il y a un continuum.
L’attitude du peuple français pendant la Grande Guerre ne contredit-elle pas la thèse d’un peuple pacifique ?
Il est incontestable que les Français ont participé à la Grande Guerre avec courage et détermination et dans une quasi-unanimité. L’ampleur de la mobilisation (8 millions d’hommes au total) et des pertes (1,3 millions de morts et 800 000 grands invalides) en témoigne. C’est en fait le résultat de plus de 40 ans d’effort des dirigeants républicains ainsi que d’un changement de la société. Celle-ci est progressivement passée d’un primat de l’individu à celui du collectif : droit syndical et d’association, organisation de grands partis politiques, systèmes sociaux (retraites, journée de huit heures) et fiscaux (dont l’impôt sur le revenu que la guerre va imposer). L’école obligatoire a permis d’inculquer à tous une série de devoirs où celui de défendre la patrie était au premier rang, conforté par un rappel incessant de la menace allemande et du souvenir des provinces perdues. La conscription raccourcie (deux ans en 1905), effective pour tous, riches ou pauvres, et effectuée dans des conditions matérielles très améliorées, a enraciné cette institution (on est passé du mauvais numéro au bon pour les filles). C’est l’ensemble de ces transformations qui a conduit au consentement à la guerre qui nous avait été déclarée. De l’effroi devant les pertes de la guerre au retour du primat de l’individualisme, un demi-siècle d’évolutions a progressivement fermé cette parenthèse dans l’histoire des mentalités françaises.
Cet entretien est également disponible sur ma page MediapartLeClub.
