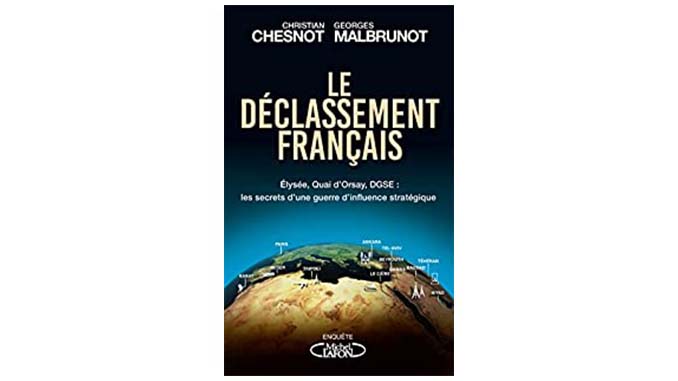
Christian Chesnot et Georges Malbrunot sont grands reporters et spécialistes du Moyen-Orient, respectivement à France Inter et au Figaro. Ils répondent à mes questions à l’occasion de la parution de leur ouvrage « Le déclassement français » aux éditions Michel Lafon.
Dans ce « déclassement français » que vous décrivez sur l’ensemble de la zone Monde arabe/Proche-Orient, quelle est la part due aux évolutions stratégiques régionales et celles dues à l’action d’Emmanuel Macron ?
Ce déclassement français au Maghreb et au Moyen-Orient a commencé en fait à la fin du mandat de Jacques Chirac dans les années 2005-2007 lorsque, obsédé par la crainte d’une fracture de la communauté internationale dans la foulée du « non » français à l’invasion américaine de l’Irak, il a entrepris un lent rapprochement avec les Etats-Unis, mais aussi au Moyen-Orient avec Israël. Le recul s’est accentué sous Nicolas Sarkozy et prolongé sous François Hollande. La France perdit alors sa voix originale dans cette région du monde. En 2017, élu, Emmanuel Macron a cherché à enrayer ce déclassement. Il s’est fortement impliqué en Algérie, au Liban, notamment, mais aussi dans le Golfe, multipliant les voyages, et marquant son début de mandat par un volontarisme, un pragmatisme qui pouvaient augurer un retour de la France au Moyen-Orient et au Maghreb. Hélas, son volontarisme ne s’est pas traduit par des résultats très probants. Il y a eu certes le Covid qui n’a pas facilité les échanges. Mais plus fondamentalement, ses tentatives d’en finir, comme il l’avait dit en juillet 2017, avec la pensée néoconservatrice ont échoué. Que ce soit en Algérie ou au Liban, son diagnostic était bon, mais la forme a laissé à désirer. Sa méthode fut probablement trop brutale. Nous dévoilons ses injonctions aux dirigeants libanais, et ses reproches extrêmement virulents au président Bouteflika et au chef d’état-major le général Gaïd Salah, par exemple.
Au Liban, son volontarisme aurait-il pu réussir ?
Il aurait pu réussir s’il avait vraiment été disruptif c’est-à-dire s’il avait par exemple mis à exécution sa menace de sanctionner les dirigeants libanais. Mais comme on le raconte dans le livre, peut-on sanctionner certains de nos alliés historiques comme Saad Hariri ? Il y a une part d’inceste dans nos relations avec le Liban. Il aurait pu aussi aller moins vite, prendre le temps d’associer les Européens à son initiative d’août 2020 et de se couvrir avec l’Iran. C’était très bien, parce que marqué par le réalisme, d’inviter le Hezbollah à ses discussions à la résidence des Pins, mais il fallait mettre l’Iran dans la boucle. Or ce travail préparatoire n’a pas été fait. Emmanuel Macron a été trop pressé d’engranger des résultats. Depuis Nicolas Sarkozy, la politique extérieure est trop vue comme un levier pour améliorer des positions en politique intérieure. On recherche trop les coups médiatiques. Or la diplomatie requiert du temps. Au Liban, Emmanuel Macron a pris les vagues engagements des dirigeants libanais comme des assurances que ceux-ci se résignaient aux réformes qu’il leur demandait. Or il n’en a rien été. Il a cru leur tordre le bras. Mais c’était méconnaitre la rouerie des zaïms – ces chefs de clans – qui trustent les maroquins depuis 30 ans. Ses conseillers auraient dû le mettre davantage en garde. Finalement, il s’est beaucoup investi, avec courage, mais sans résultat, ce qui, d’une certaine façon dégrade quelque peu, la parole présidentielle.
Vous décrivez Emmanuel Macron comme brillant et intellectuellement au-dessus du lot, mais trop solitaire dans l’exercice du pouvoir ?
C’est l’un des reproches qui lui est fait par certains diplomates ou ex-diplomates qui ont travaillé avec lui. Emmanuel Macron comprend avec fulgurance les problématiques complexes du Moyen-Orient. Il travaille beaucoup. Il parle bien l’anglais. Mais il a tendance à penser qu’il peut faire beaucoup de choses tout seul. Il n’écoute probablement pas assez, nous ont dit plusieurs diplomates qui ont travaillé avec lui. Sur la Libye, le témoignage de Ghassan Salamé l’envoyé spécial de l’ONU est, de ce point de vue, éloquent, quand il nous décrit ses rencontres avec Angela Merkel et Emmanuel Macron. Deux styles bien différents. D’autre part, le chef de l’Etat estime qu’en bousculant ses interlocuteurs, il fera bouger les lignes. Il a essayé avec l’Iran et Hassan Rohani avec lequel il avait construit une bonne relation après de nombreux appels téléphoniques, mais cette bonne relation a été ternie par des initiatives malheureuses comme celle en marge de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre 2019 où Emmanuel Macron a voulu forcer Rohani à parler au téléphone avec Donald Trump. C’était une illusion de croire que Rohani pouvait s’affranchir de l’aval du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, farouchement hostile à ce type de contact avec l’ennemi américain. Encore une fois, ces erreurs sur la forme sont regrettables, car sur le dossier iranien, Emmanuel Macron avait affiché un pragmatisme intéressant. Enfin, il a encore renforcé la présidentialisation de la politique étrangère française, marginalisant le Quai d’Orsay.
La nature de nos débats de politique intérieure a-t-elle également joué ?
Le débat – voire l’obsession de certains responsables politiques vis-à-vis de l’islam, associé à tort à l’islamisme – dégrade l’image de la France au Moyen-Orient et au Maghreb. Les musulmans de ces régions – dont certains plutôt conservateurs – se disent souvent que les Français ont un problème avec l’islam. Emmanuel Macron avait pourtant bien commencé son mandat en prenant soin de faire le distinguo entre islam et islamisme. Mais en administrant une leçon sur « l’islam en crise » à 1,7 milliard de musulmans lors de son discours aux Mureaux après l’assassinat du professeur Samuel Paty, il en a heurté de très, très nombreux à l’étranger. Si sur le fond il n’avait pas tort, il n’avait pas à le dire ainsi. Pour la première fois depuis de nombreuses années, des portraits d’un président de la République ont été brûlés au Pakistan, en Libye ou dans la bande de Gaza. Au final, notre recul n’est pas que diplomatique, il est aussi économique et commercial, et passe aussi par le recul de la pratique du français dans des bastions comme le Liban, par exemple.
Cet entretien est également disponible sur MediapartLeClub.
