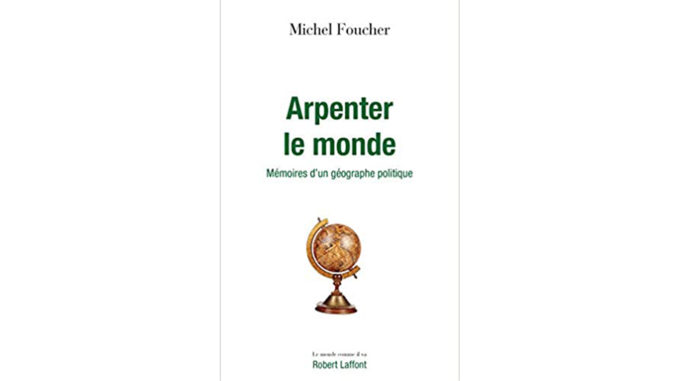
Michel Foucher universitaire diplomate et conseiller du prince a, au cours des 50 dernières années, voyagé dans 125 pays. Dans Arpenter le monde : Mémoires d’un géographe politique (Michel Laffont), il nous livre ses mémoires et les réflexions tirées de ses multiples expériences.
La géopolitique risque-t-elle l’insignifiance en étant réduite un synonyme de relations internationales ?
L’emploi généralisé du terme « géopolitique » relève d’un effet de mode qui comporte un aspect positif, marquant un intérêt partagé pour les affaires du monde, ce qui fait partie de la culture citoyenne. Mais la synonymie avec les relations internationales et la quasi-substitution contribuent à évacuer le préfixe « géo » du raisonnement et du récit, ce qui interdit une compréhension approfondie des enjeux. Or la géographie est un savoir précis et profond, qui ne s’improvise pas, notamment par sa méthode d’étude multi-scalaire des situations. La carte n’est pas une image pillée à l’envi, mais un texte à déchiffrer à partir de sa légende (du latin « legenda », ce qui est à lire). Et, pour moi, n’est géographique que ce qui peut être représenté par la cartographie, qui est un vrai métier. Mon témoignage entend rappeler les vertus de l’art géographique dans sa dimension de compréhension du mouvement dans un espace concret, ce qui confine avec la stratégie au sens propre. Si la corporation des géographes n’avait pas, sous l’influence des historiens et par provincialisme, déserté le terrain du Politique (à l’exception de leur contribution au dessin des frontières en 1919 et en 1945, vite refoulée), l’emploi du mot « géopolitique » se serait avéré inutile. Le risque est que la géopolitique enseignée comme spécialité dans les lycées par des professeurs formés d’abord à l’histoire (seuls 9% des enseignants d’histoire-géographie ont une formation supérieure de géographes) ne connaisse le destin de la géographie, sa réduction à une discipline scolaire alors qu’il s’agit d’un savoir stratégique à vocation pratique.
Comment s’articule en France la relation entre le décideur et l’expert ?
En France, la relation entre décideur et expert est structurellement difficile, si du moins l’on raisonne en longue durée. L’appareil d’État, pour des raisons historiques et statutaires, ne favorise pas la mobilité entre les deux univers. Rien de commun avec la pratique du système américain des dépouilles qui, malgré ses défauts, permet à d’anciens décideurs d’écrire leurs mémoires dans des sociétés de pensée stratégique et de se préparer à revenir au pouvoir. Il suffit d’examiner les trajectoires des actuels responsables de la politique étrangère américaine pour s’en convaincre : ils étaient prêts. De plus, les règles strictes d’accès aux archives en France constituent un véritable obstacle à la rédaction de textes relatant les passages au pouvoir. L’État français fonctionne toujours comme un sujet supposé tout savoir. Pourquoi voulez-vous, m’a-t-on objecté un jour dans un cabinet ministériel, que l’État accorde foi à une analyse qu’il n’a pas produite lui-même ? Il arrive pourtant que des décideurs éprouvent le besoin de recourir à des chercheurs pour démêler des situations nouvelles, notamment quand il s’agit de crises où les facteurs ethniques et religieux, les questions de frontières et de territoires sont en jeu qui ne peuvent pas être traitées par les canaux habituels de la diplomatie. Ce fut le cas lors de la désintégration violente de la Yougoslavie ou au début des guerres afghanes. Un autre domaine où l’expertise peut être utile est celui de la diplomatie informelle et discrète qui a le mérite de ne pas engager les appareils diplomatiques. On vient de le noter dans la reprise de contact entre l’Iran et l’Arabie saoudite en Irak, préparée par la publication d’articles de presse ouverts à l’autre protagoniste et rédigés avec l’aval des deux gouvernements. La France reste assez peu familière de cette pratique dite « Track Two », à la différence de la Suisse ou de la Norvège.
Alors que les accords d’Oslo n’étaient pas remis en cause, vous annoncez à Yasser Arafat qu’il n’aura pas d’Etat…
C’est Khalil Toufakji, chef du département d’études cartographiques de la société d’études arabes, longtemps installée dans la Maison d’Orient à Jérusalem, qui avait tenté d’expliquer à Arafat, en 1995, la réalité, inaudible pour lui, de l’absence d’État palestinien si l’on parlait à partir des cartes. Pour ma part, dialoguant avec Yasser Arafat trois ans plus tard dans son bunker de Ramallah, par l’intermédiaire de Leïla Chahid, alors représentante de l’Autorité palestinienne en France, j’avais essayé de lui faire comprendre l’importance de la géographie concrète dans les négociations du processus de paix, dont l’enjeu était d’abord territorial, et de lui faire admettre la nécessité de former des cartographes palestiniens au ministère du Plan. Il l’avait admis, mais il m’avait laissé l’impression d’être un rêveur autour d’une Palestine idéalisée au centre d’un monde arabe mythique.
L’usage en France du terme Soft Power vous agace pourquoi ?
Je m’insurge contre l’usage de ce néologisme anglo-américain pour deux raisons. La première est liée à l’étymologie. L’inventeur de cette formule, Joseph Nye, l’avait déduite de la notion de base, le « hard power », les deux étant pour lui indissociablement liées. Parler de « soft power » en oubliant ce lien conduit à un contre-sens, à une sorte d’édulcoration alors que le « soft power » est, pour Joseph Nye, ancien secrétaire d’État adjoint à la défense sous Clinton, une stratégie de coercition excluant le recours à la violence. Les échanges que j’ai eus avec lui sur ce point sont sans ambiguïté. Hillary Clinton a introduit la notion de « smart power » à propos de la liberté de manifester via les réseaux sociaux (dans le contexte des rassemblements démocratiques en Ukraine et du rôle possible des réseaux sociaux en Chine). Le « smart » désigne ne fait une lutte contre les régimes autoritaires. On peut inclure dans cette catégorie les modalités contemporaines de la propagande et de la désinformation d’un pays comme la Russie, qui n’est pas « une puissance douce » (pour « soft »).
La deuxième raison procède de mon refus de cette paresse française d’employer des termes existants, tels que l’influence ou la référence. Le dérèglement sémantique en France atteint des proportions inquiétantes, que j’ai analysées dans mon « Atlas des mondes francophones » (Carrefour market et city, Choose France, My French Bank dans les bureaux de poste). En l’espèce, on préfère, même dans les cercles officiels, parler de « soft power à la française », expression absurde et contradictoire.
Cet article est également disponible sur MediapartLeClub.
