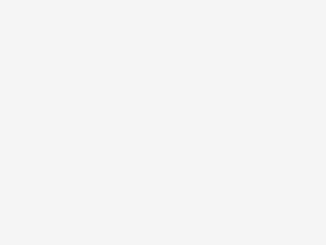Bernard Ravenel, agrégé d’histoire, fut responsable des relations internationales du PSU. Ancien président de l’AFPS (2001-2009) et de la plate-forme des ONG françaises pour la Palestine (2001-2011), il répond à mes questions à l’occasion de la parution de l’ouvrage : « La résistance palestinienne : des armes à la non-violence », aux éditions L’Harmattan.
Pourquoi, selon vous, le succès de la première Intifada tient-il à son caractère à 95% non violent ?
En 1987, l’Intifada a éclaté au sein d’un contexte caractérisé par un climat de désobéissance civile. En effet, la société civile palestinienne (syndicats, mouvements étudiants, organisations de femmes, etc.) s’est organisée à travers la création de multiples associations et d’organisations non gouvernementales. Considérant comme impossible toute résistance armée dans les territoires occupés, les organisations politiques membres de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), en particulier l’influent Parti communiste jordano-palestinien, ont fondé ce réseau associatif de masse, guidé par un double objectif : prendre en charge les secteurs vitaux négligés par les autorités israéliennes (hôpitaux, agriculture) d’un côté, et développer la conscience nationale pour une mobilisation politique de masse contre l’occupation de l’autre côté. Toujours en 1987, la société palestinienne, soumise à une occupation qui couvre une accélération de la colonisation après l’arrivée de Sharon en 1979 comme ministre de l’Agriculture, connaît une effervescence grandissante. La tendance principale est alors l’affirmation d’un processus d’autonomie de vie face à l’occupant, ce qui suppose de désobéir à ses injonctions et à ses contraintes. Il faut enfin prendre en compte la grande défiance dans le processus politico-diplomatique du moment. Il suffira alors d’un grave incident meurtrier (mort de quatre ouvriers palestiniens causée par un chauffeur de camion israélien à Gaza) pour qu’éclate le soulèvement, qui se diffusera rapidement sur l’ensemble des territoires occupés.
Quelques jours après, la direction extérieure de l’OLP à Tunis et son stratège, Abou Djihad, demande et ordonne que ne soit utilisée aucune arme à feu. Cette décision, historique, fut respectée intégralement pendant de nombreux mois, démontrant ainsi l’incontestable légitimité populaire de la centrale palestinienne. À partir de ce moment, se développe une insurrection civile sans précédent dans le monde arabe.
La véritable surprise a été sa nature durablement non violente. Certains ont voulu contester cette qualification en insistant sur la violence que constitue l’usage de la pierre comme moyen de résistance : ils parlèrent ainsi de « guerre des pierres ». En réalité, la fonction des « lanceurs de pierres » a été de jouer, en accord explicite avec le « mouvement », le rôle d’avant-poste du territoire de leur communauté. Bien que constituant un certain niveau de violence – ciblant essentiellement les véhicules blindés israéliens – elle se situe à l’intérieur de la stratégie de résistance populaire non violente, contrainte à déployer et à maîtriser une certaine dose de violence, mais ne visant jamais à tuer. Mais, surtout, il faut considérer comment le recours aux pierres, mais non aux armes à feu, a démontré aux yeux du monde, et en particulier aux citoyens israéliens, que la « menace » palestinienne venue de l’Intifada ne mettait pas en cause, même symboliquement, l’existence physique ou la « sécurité » d’Israël, au nom de laquelle il justifiait ses guerres. La menace potentielle vise l’occupant israélien, mais non le territoire israélien au sein des frontières de 1949.
En dernière analyse, le fait majeur de l’Intifada est d’ordre stratégique : la puissance destructrice de la machine de guerre israélienne a été en bonne partie neutralisée face à une population entièrement désarmée. Elle n’a pas réussi à écraser l’Intifada. Tel est le sens profond de la défaite militaire d’Israël et de la victoire politique des Palestiniens.
Vous expliquez qu’Israël avait pour objectif la militarisation de la seconde Intifada. Pouvez-vous développer ?
Il ne faut jamais oublier qu’Israël est déterminé à se vouloir victime. Les Palestiniens n’eurent jamais les moyens de constituer une menace militaire. Mais, pour le pouvoir israélien, le fait de se trouver face à une « force » armée, fût-elle fictive, confère sa légitimité à la stratégie militaire d’occupation et de colonisation. Face à cette nouvelle insurrection qu’est la seconde Intifada, la stratégie israélienne est claire : éviter à tout prix le renouvellement d’une Intifada du type de la première, restée longtemps non armée et dont la tentative de répression militaire avait été délégitimée par l’opinion internationale, permettant ainsi une victoire politique palestinienne. D’où la décision de militariser le conflit en provoquant une réaction armée des Palestiniens, afin de se voir reconnu le droit d’employer les armes, y compris les plus lourdes (chars, hélicoptères). Ce qui s’est d’ailleurs effectivement produit.
Vous expliquez également que le mouvement palestinien a pris conscience qu’un principe essentiel était de se battre sur un autre terrain que celui choisi par l’adversaire. Pourquoi ?
C’est précisément à partir de la pratique de la non-violence, c’est-à-dire en passant explicitement de la violence armée à la non-violence, que les Palestiniens ont compris que les Israéliens avaient perdu un pouvoir essentiel : celui de se présenter devant l’opinion publique internationale comme victime des armes palestiniennes. De fait, l’état de victime du pacifisme ou de la non-violence est peu glorieux. Les Israéliens ont alors inventé le terme de « terrorisme pacifiste » pour être plus crédibles et justifier leur violence armée contre une population désarmée…mais sans réussir.
En réalité, le terrain de la non-violence choisi par les Palestiniens, largement médiatisé, qui a rendu simultanément visibles l’image de la non-violence palestinienne et celle de la violence israélienne, a abouti à une chute sans précédent de la légitimité de la violence israélienne. Elle a ruiné la totalité des efforts du système médiatique israélien visant à légitimer l’usage de l’extrême violence, ou de la riposte « disproportionnée ». D’où, aujourd’hui, la volonté des autorités israéliennes de mettre en place une stratégie de communication, où le poids des mots et des photos peut pencher en leur faveur : c’est l’actuel objet de la bataille médiatique et sémantique pour assimiler toute résistance palestinienne, en particulier celle non violente, au terrorisme et à l’antisémitisme.
Dans ce monde où règne la communication télévisée en temps réel, la transmission de la résistance non violente est devenue un enjeu majeur pour l’image de la lutte palestinienne, mais aussi pour le pouvoir israélien très soucieux de présenter les Palestiniens comme l’ennemi terroriste, et de se présenter comme potentielle victime d’une menace permanente des Arabes.